En 2020, l’État a mis en place le Prêt Garanti par l’État (PGE) pour sauver les entreprises pendant la crise sanitaire. Cinq ans plus tard, la plupart des sociétés ont commencé à rembourser, souvent après deux ans de différé. Mais en 2026, la situation a changé : beaucoup de dirigeants ne parviennent plus à suivre les échéances. Malgré des efforts pour renégocier ou reporter, les banques ferment désormais la porte à la majorité des demandes de rééchelonnement. Face à cette impasse, une question s’impose : que reste-t-il à faire quand le PGE devient insoutenable ? Ce guide fait le point sur les dispositifs encore disponibles, les limites des reports bancaires et les alternatives patrimoniales qui permettent de reprendre le contrôle avant le redressement judiciaire.
2026 : la fin des reports automatiques
Jusqu’en 2023, de nombreuses entreprises ont pu bénéficier d’un report exceptionnel des échéances PGE. Ces aménagements, validés par la BPI et le ministère de l’Économie, permettaient de repousser d’un an la première échéance. Mais depuis 2024, ces mesures ne sont plus automatiques. En 2026, les reports sont accordés uniquement sur décision de la banque, au cas par cas, après analyse de la situation financière. Autrement dit : si votre entreprise présente des difficultés structurelles, votre demande de report a toutes les chances d’être refusée. C’est ce que confirme la hausse des refus de refinancement observée par les experts de PraxiFinance.
Les critères pour obtenir un report en 2026
Les banques examinent désormais trois éléments avant d’accorder un report ou un rééchelonnement :
– la capacité d’autofinancement réelle,
– les résultats du dernier exercice,
– et la valeur des garanties ou du patrimoine du dirigeant.
Si ces critères ne sont pas réunis, le report est écarté. Certaines banques demandent même une nouvelle caution personnelle ou une garantie sur un bien immobilier, ce qui augmente le risque patrimonial du chef d’entreprise. Dans ce contexte, beaucoup préfèrent explorer d’autres solutions plus sûres et rapides, notamment la vente à réméré, présentée dans vente à réméré : une solution pour rembourser un PGE.
Rééchelonner son PGE : un parcours d’obstacles
Le rééchelonnement consiste à allonger la durée du prêt pour réduire la mensualité. Théoriquement, c’est possible jusqu’à 10 ans, mais en pratique, les banques refusent désormais de dépasser 6 ou 7 ans. Elles craignent une requalification en aide d’État illégale ou une défaillance à long terme. De plus, le rééchelonnement nécessite l’accord de la BPI France, qui garantit une partie du prêt. Les procédures sont longues, complexes, et rarement acceptées sans plan de redressement solide. C’est pourquoi la plupart des dirigeants se retrouvent face à un mur : plus de possibilité de report, plus de refinancement.
Les alternatives sont alors de trois ordres :
- La médiation du crédit, pour tenter une solution amiable,
- La restructuration via mandat ad hoc,
- La monétisation du patrimoine personnel, notamment par réméré.
Ces trois axes sont détaillés dans PGE et surendettement d’entreprise : que faire ?.
Pourquoi la vente à réméré devient une solution de gestion de trésorerie
La vente à réméré permet à un dirigeant propriétaire de son bien (résidence principale, secondaire, immeuble professionnel) de dégager immédiatement jusqu’à 50 % de la valeur de ce bien, sans passer par la banque. Cette somme peut être utilisée pour rembourser le PGE, régler d’autres dettes urgentes ou réinjecter des fonds dans l’entreprise. Le principe est simple : le bien est vendu temporairement à un investisseur, le dirigeant conserve l’usage du bien et peut le racheter plus tard à un prix fixé dès le départ. C’est une solution légale, notariée et sécurisée, qui permet de sauver l’entreprise sans la brader. De nombreux dirigeants y ont recours lorsque la banque refuse de refinancer le PGE, comme décrit dans refus bancaire pour refinancer un PGE.
La combinaison gagnante : plan de redressement et solution patrimoniale
Les dirigeants les plus lucides adoptent une stratégie mixte :
– ils sollicitent un report ou un rééchelonnement partiel auprès de leur banque,
– et en parallèle, mettent en place un plan patrimonial de financement.
Cette combinaison permet de réduire la pression mensuelle tout en assurant un remboursement immédiat du PGE à hauteur partielle. En pratique, cette méthode séduit de plus en plus de dirigeants confrontés à une procédure de redressement judiciaire (voir PGE et redressement judiciaire : quelles conséquences ?). L’objectif n’est pas de s’endetter à nouveau, mais de racheter du temps pour sauver l’activité.
Quand la banque dit non : la voie patrimoniale comme dernier rempart
Lorsqu’un dirigeant reçoit un courrier de refus de report ou de refinancement, il se retrouve souvent sans solution immédiate. Or, chaque mois de retard entraîne des pénalités et peut déclencher une mise en demeure bancaire, voire une caution personnelle engagée (voir caution personnelle et PGE : comment protéger son patrimoine ?). C’est précisément dans ces situations que la vente à réméré devient une bouée de sauvetage. Elle permet non seulement de rembourser la dette, mais aussi de préserver la structure juridique de l’entreprise. En agissant vite, avant la déchéance du terme, le dirigeant conserve la main sur sa stratégie.
Témoignage : une société de transport sauvée grâce à un réméré
Paul, dirigeant d’une société de transport à Bordeaux, devait rembourser 290 000 € de PGE en 2026. La banque a refusé le report et a menacé d’appeler la caution personnelle. Grâce à une vente à réméré sur sa résidence estimée à 600 000 €, il a obtenu 280 000 € de liquidités sous trois semaines. Il a soldé le PGE, relancé son activité, et a pu racheter son bien 18 mois plus tard. Une solution simple, rapide, et surtout sans faillite.
L’après-report : anticiper pour ne pas subir
Même si un report est accordé, il ne fait que repousser le problème. Les dirigeants doivent impérativement utiliser ce délai pour stabiliser leur trésorerie, renégocier leurs dettes fournisseurs et anticiper la fin du PGE. Dans ce contexte, la monétisation patrimoniale (réméré, complément de prix, prêt hypothécaire) reste l’arme la plus efficace pour éviter une impasse. Ces leviers sont détaillés dans prêt garanti par l’État : que faire après l’échéance ?.
Conclusion : le report ne suffit plus, il faut agir
Le PGE à rembourser est devenu le symbole d’un système sous tension. Les banques ne peuvent plus tout absorber, et les entreprises ne peuvent plus tout payer. En 2026, la seule approche réaliste consiste à agir avant la rupture, en combinant les outils bancaires et patrimoniaux. Grâce à la vente à réméré, les dirigeants peuvent rembourser leur PGE, protéger leur patrimoine et préserver leur entreprise, tout en préparant l’avenir avec sérénité. Découvrez dès maintenant la vente à réméré, la solution la plus rapide pour faire face aux échéances du PGE.
FAQ — Report ou rééchelonnement du PGE en 2026
Peut-on encore obtenir un report du PGE ?
Oui, mais seulement sur décision de la banque. Les reports automatiques n’existent plus depuis 2024.
Faut-il passer par la BPI pour rééchelonner un PGE ?
Oui, car la BPI est garante d’une partie du prêt. Son accord est indispensable pour toute prolongation.
Quelles alternatives si la banque refuse le report ?
Vous pouvez recourir à la vente à réméré, à la vente avec complément de prix ou à un crédit hypothécaire. Ces options sont décrites dans vente à réméré pour rembourser un PGE.
Est-il risqué d’attendre avant d’agir ?
Oui. Tout retard augmente les pénalités et peut déclencher l’appel de la caution personnelle.
Peut-on utiliser le réméré pour refinancer aussi l’entreprise ?
Absolument. Le capital dégagé peut servir à rembourser le PGE et à réinjecter de la trésorerie dans la société.

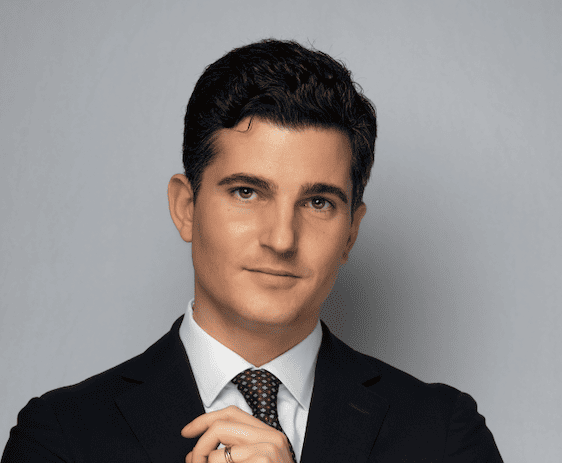




.svg)






