Depuis 2024, la plupart des demandes de refinancement des Prêts Garantis par l’État (PGE) sont désormais rejetées. Les banques, autrefois conciliantes, appliquent aujourd’hui des critères beaucoup plus stricts. Un dirigeant qui cherche à rééchelonner son PGE ou à obtenir un nouveau financement pour en assurer le remboursement se retrouve face à une série de refus. Leur logique est implacable : risque trop élevé, rentabilité insuffisante, et fin de la garantie de l’État. Ce constat laisse des milliers d’entrepreneurs dans une situation critique. Alors, que faire lorsque la trésorerie s’assèche, que les relances s’enchaînent et que la banque ne propose plus aucune solution ? Des alternatives existent en dehors du circuit bancaire traditionnel, notamment des mécanismes patrimoniaux comme la vente à réméré, qui s’ajoutent aux autres solutions de financement pour entreprises en difficulté. Dans ce contexte, la capacité du dirigeant à identifier rapidement ces solutions parallèles devient un facteur clé de survie : plus il attend, plus le champ des possibles se rétrécit et plus la banque prend l’ascendant dans la relation. À cela s’ajoute un facteur aggravant : l’économie actuelle reste instable, et les entreprises doivent absorber des coûts fixes plus élevés tout en composant avec une consommation devenue irrégulière. Les banques considèrent désormais que toute demande liée à un PGE indique un risque structurel, même si l’activité reste viable. Ainsi, un simple besoin de trésorerie devient un signal d’alerte rouge. Le dirigeant se retrouve alors isolé, face à un système bancaire qui n’a plus vocation à l’accompagner.
Pourquoi les banques refusent-elles de refinancer les PGE ?
Le PGE a été conçu comme une aide exceptionnelle et temporaire. L’État garantissait jusqu’à 90 % du risque de non-remboursement, ce qui permettait aux banques d’accorder des crédits sans frilosité. Mais depuis la fin du dispositif, la garantie publique ne s’applique plus aux refinancements. Concrètement, si la banque accorde un nouveau prêt à une entreprise déjà endettée, elle prend 100 % du risque. C’est la raison principale des refus : le risque de défaut est trop important, surtout lorsque le PGE initial n’est pas soldé. Ajoutons à cela : la hausse des taux d’intérêt, le durcissement des critères Bâle III et IV, la baisse des marges de liquidité, et la hausse des incidents de paiement. Pour comprendre les options restantes, relisez le sujet du refinancement d’entreprise en difficulté qui détaille les dernières marges bancaires possibles. Il faut aussi comprendre que les banques subissent des contraintes réglementaires croissantes. La moindre opération risquée peut impacter leurs ratios prudentiels. Ainsi, même un dossier solide peut être refusé s’il augmente la sensibilité globale du portefeuille. Les conseillers bancaires eux-mêmes n’ont plus la latitude qu’ils avaient en 2021 ou 2022 : leur marge de manœuvre est devenue extrêmement limitée. Résultat : même les entreprises encore rentables mais momentanément tendues sont assimilées à des profils fortement risqués, ce qui ferme presque automatiquement la porte aux demandes de refinancement. Le résultat est un système bancaire verrouillé, laissant les dirigeants désemparés face à un mur administratif.
Refus bancaire : les conséquences immédiates
Le refus de refinancement n’est pas anodin. Il signifie que l’entreprise ne pourra plus accéder à de nouveaux financements à court terme. Ce refus est également enregistré dans les bases internes des établissements et, dans certains cas, signalé à la Banque de France. Cela peut entraîner : une notation défavorable, la réduction des lignes de découvert, la suspension des partenariats avec les fournisseurs, voire l’engagement de la caution personnelle du dirigeant. Pour éviter l’engrenage, il faut agir immédiatement après le premier refus, avant que la banque ne déclare la déchéance du terme, notamment en explorant le financement urgent entreprise pour éviter la rupture de trésorerie. De plus, un refus peut déclencher une réaction en chaîne : les assurances-crédit réduisent les limites sur l’entreprise, les fournisseurs imposent des paiements comptants, et les clients hésitent à signer de nouveaux contrats. L’image de l’entreprise se dégrade avant même que la trésorerie ne tombe dans le rouge. Beaucoup de dirigeants sous-estiment cet effet domino qui, à lui seul, peut précipiter un dépôt de bilan. C’est précisément à ce moment charnière qu’une décision rapide en faveur d’une solution patrimoniale peut inverser la dynamique et restaurer la confiance des partenaires.
Les recours possibles après un refus
1. La médiation du crédit
Le premier réflexe est de solliciter la médiation du crédit via la Banque de France. Ce dispositif peut suspendre temporairement les échéances et rouvrir un dialogue entre la banque et l’entreprise. Mais attention : la médiation ne crée pas de financement, elle ne fait que gagner du temps. Dans certains cas, la médiation permet de rétablir une relation de confiance, mais elle échoue souvent lorsque la banque considère que le risque est trop important. Les dirigeants doivent alors envisager d’autres leviers plus concrets.
2. Le plan de restructuration amiable
Si le médiateur échoue, un mandat ad hoc peut être ouvert par le tribunal de commerce. Ce dispositif permet de négocier un plan d’apurement ou un étalement. Cependant, sans apport de trésorerie, la restructuration reste fragile. C’est pourquoi les experts PraxiFinance orientent souvent les dirigeants vers une solution patrimoniale immédiate, comme le réméré ou la vente avec complément de prix. Ces mécanismes rejoignent les approches vues dans les stratégies de financement alternatif pour entreprises sous tension. Le mandat ad hoc est utile, mais il ne peut fonctionner qu’avec un minimum de liquidités. Un plan sans argent est un plan qui échoue presque toujours. Les tribunaux eux-mêmes rappellent régulièrement que le succès d’une restructuration repose sur la capacité du dirigeant à injecter des ressources nouvelles dans l’entreprise. En pratique, cela signifie qu’un plan crédible est presque toujours adossé à une opération de monétisation patrimoniale, qu’elle soit réalisée sur un bien personnel ou sur un actif détenu par la société.
Le levier patrimonial : transformer la valeur de son bien en trésorerie
Lorsqu’une entreprise n’a plus accès au crédit bancaire, la seule alternative crédible consiste à mobiliser le patrimoine immobilier du dirigeant ou de la société. La vente à réméré est aujourd’hui la solution la plus rapide et la plus sûre. Le principe est simple : le bien est vendu temporairement à un investisseur, le vendeur perçoit immédiatement jusqu’à 50 % de la valeur du bien, et conserve la possibilité de le racheter plus tard, une fois l’entreprise stabilisée. Le notaire règle directement le PGE, les dettes sociales et fiscales, puis reverse le solde au dirigeant. C’est un outil de gestion de crise permettant de solder le PGE et protéger la résidence principale, tout comme expliqué dans le sujet vente à réméré entreprise en difficulté. Cette solution présente également un avantage stratégique : elle permet d’éviter une déchéance du terme, qui pourrait entraîner une cascade de poursuites judiciaires. Le réméré agit comme un pare-chocs financier, stoppant immédiatement la pression bancaire tout en redonnant au dirigeant une visibilité sur sa situation. Il permet aussi de préserver un bien stratégique — maison, immeuble professionnel, local commercial — qui aurait été perdu en cas de liquidation. En d’autres termes, le patrimoine n’est plus seulement un passif à protéger, il devient un levier actif de financement, au service de la continuité de l’activité.
Le complément de prix : alternative souple pour les dirigeants pressés
Lorsqu’un bien immobilier professionnel ou personnel ne peut être cédé en réméré, la vente avec complément de prix devient une alternative pertinente. Elle permet au dirigeant de percevoir immédiatement une avance de trésorerie représentant 40 à 50 % de la valeur du bien, puis de récupérer le solde lors de la revente finale. Cette opération, rapide (3 à 4 semaines en moyenne), permet de rembourser le PGE et de relancer l’activité sans passer par la banque, une solution appréciée dans les cas de crédit entreprise en difficulté où l’accès aux financements est limité. Le complément de prix est souvent choisi par les entrepreneurs qui souhaitent conserver leur flexibilité. Il ne comporte aucune obligation de rachat, contrairement au réméré, et permet de sortir rapidement d’une situation de crise. C’est une solution intermédiaire mais très efficace pour éviter une faillite imminente.
Caution personnelle : un risque souvent sous-estimé
Un refus de refinancement peut entraîner l’activation de la caution personnelle du dirigeant. Cela signifie que la banque peut exiger le remboursement du PGE sur le patrimoine privé. Cette situation touche des milliers de chefs d’entreprise qui découvrent, souvent trop tard, que leur maison est exposée. Pour éviter cela, il faut rembourser le PGE avant que la banque n’appelle la caution. La vente à réméré permet précisément cela : le notaire règle la banque et met fin à la caution, comme l'explique notre ressource sur le financement sans banque. Protéger sa résidence principale devient alors une priorité absolue. Beaucoup ignorent qu’une action rapide peut empêcher une saisie immobilière. Anticiper permet au dirigeant d’éviter non seulement la perte de son bien, mais aussi un fichage Banque de France durable.
Exemple concret : un restaurateur qui évite la faillite grâce à la monétisation
Marc, restaurateur à Toulouse, avait contracté un PGE de 180 000 € en 2020. En 2024, son chiffre d’affaires a chuté de 30 %. La banque a refusé tout refinancement, invoquant un endettement trop élevé. Grâce à la vente à réméré de son appartement, Marc a obtenu 150 000 € en 15 jours. Il a soldé le PGE, relancé son activité, et racheté son bien un an plus tard. Aujourd’hui, son restaurant fonctionne de nouveau, sans dette bancaire, comme d'autres dirigeants ayant mobilisé le crédit hypothécaire entreprise en difficulté. Ce type de rebond illustre l’intérêt des solutions patrimoniales : elles permettent non seulement de traverser la crise, mais aussi de repartir sur une base saine, débarrassée de la pression bancaire.
La bonne stratégie : anticiper avant la rupture
Le dirigeant doit réagir dès le premier refus bancaire, avant le commandement de payer. Plus il agit tôt, plus les solutions sont nombreuses. Le réméré, la vente avec complément de prix ou le crédit hypothécaire sont efficaces uniquement tant que le bien n’est pas saisi. Une fois le dossier transmis au tribunal, la marge de manœuvre se réduit considérablement. Il est donc essentiel d’agir dès les premiers signaux d’alerte, comme le rappelle l'approche financer son entreprise sans les banques. Les dirigeants qui réagissent tôt disposent d’un avantage décisif : ils choisissent leur solution, au lieu de la subir. L’anticipation est la clef, car aucune solution patrimoniale ne peut être mise en œuvre lorsque le bien est déjà sous procédure de saisie ou soumis à une inscription judiciaire.
FAQ — Refus de refinancement du PGE
Pourquoi ma banque refuse-t-elle de refinancer mon PGE ?
Parce que la garantie de l’État ne s’applique plus aux nouveaux prêts. La banque prend donc 100 % du risque.
Puis-je changer de banque pour refinancer ?
Peu probable. Toutes appliquent les mêmes règles de risque. Le refus d’une banque en entraîne souvent d’autres.
Que faire immédiatement après un refus ?
Agissez avant le défaut de paiement : contactez un expert pour mettre en place une solution patrimoniale.
Le réméré est-il risqué ?
Non. C’est une vente notariée encadrée par le Code civil. Le vendeur garde la possibilité de racheter son bien à un prix fixé dès le départ.
Combien de temps faut-il pour obtenir des liquidités via un réméré ?
Entre 15 et 25 jours selon la complexité du dossier.
Le refus de refinancement entraîne-t-il un fichage Banque de France ?
Pas toujours, mais c’est fréquent après deux incidents de paiement. Agir vite permet de l’éviter.
Pour aller plus loin, découvrez comment la vente à réméré peut permettre de rebondir après un refus bancaire tout en protégeant son patrimoine et son activité.

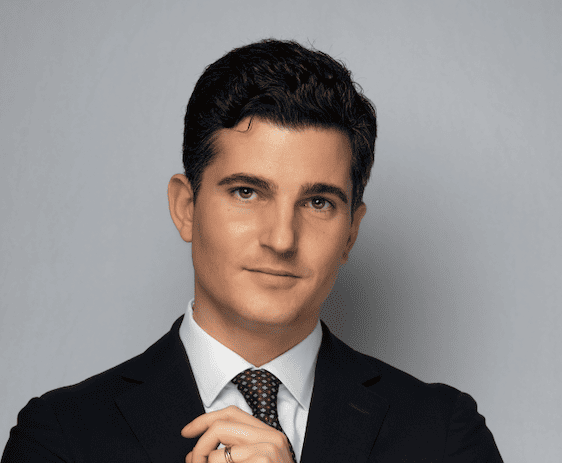




.svg)






