En 2026, de nombreuses entreprises arrivent au terme de leur PGE. Pour certaines, le remboursement est terminé. Pour d’autres, les échéances finales sont impossibles à honorer, les banques refusent toute prolongation, et la trésorerie est exsangue. À ce stade, il ne s’agit plus de demander des délais, mais d’éviter la mise en demeure et la procédure de recouvrement. Lorsqu’aucune solution bancaire n’est accessible, la réponse la plus efficace consiste à mobiliser son patrimoine via une vente à réméré, comme cela se pratique déjà dans de nombreux dossiers de contentieux bancaire.
Pourquoi les banques refusent toute prolongation après échéance
Bien que le PGE puisse théoriquement courir jusqu’à dix ans, la majorité des banques ont limité à six ou sept ans et exigent désormais le solde. À l’échéance, elles refusent presque systématiquement d’allonger la durée. Passée cette phase, elles appliquent les mêmes étapes que dans la procédure de contentieux bancaire : mise en demeure, puis recouvrement si aucun apport n’est annoncé.
Les risques du non-remboursement après échéance
En cas de défaut, la banque peut prononcer la déchéance du terme et réclamer la totalité du capital restant dû. Les dirigeants qui se sont portés cautions voient leur patrimoine privé exposé. Cette mécanique ressemble à celle décrite dans le contexte d’une caution personnelle face à une banque.
Les solutions patrimoniales pour agir après échéance
Lorsque plus aucun financement bancaire n’est possible, il faut activer un levier patrimonial pour rembourser la banque. La vente à réméré permet de transformer une partie de la valeur du bien immobilier en liquidités immédiates, sans passer par un crédit, afin de rembourser le PGE et repartir en position saine. Ce type de solution s’inscrit dans la logique détaillée pour sortir d’un contentieux bancaire.
Les aides et recours encore disponibles en 2026
Certaines entreprises peuvent encore solliciter la médiation du crédit ou le CODEFI, mais uniquement si leur situation financière est jugée viable — et les délais sont longs. Lorsque les échéances sont déjà impayées ou que le fichage menace, la seule réponse concrète est patrimoniale, comme cela est observé dans les situations de contentieux bancaire et FICP.
Exemple : éviter la liquidation après échéance du PGE
Un dirigeant d’entreprise du BTP à Lyon a soldé 280 000 € de PGE grâce à une vente à réméré sur un bien estimé à 600 000 €. Il a évité la mise en jeu de sa caution, préservé son entreprise et récupère aujourd’hui sa capacité bancaire. Ce type d’issue est comparable aux stratégies utilisées pour éviter une saisie immobilière après contentieux.
Comment préparer une opération de réméré
Dès la fin du PGE, il faut évaluer le patrimoine, rassembler les pièces bancaires et mandat notarier pour déclencher l’opération. Les fonds sont en moyenne libérés sous 20 à 30 jours. La démarche reprend les mêmes étapes que celles détaillées pour sortir d’un contentieux bancaire.
FAQ — PGE après échéance
Peut-on prolonger un PGE au-delà de l’échéance ?
Non, sauf accord exceptionnel. En 2026, ces acceptations sont extrêmement rares.
Que se passe-t-il après un refus de refinancement ?
La banque peut exiger le capital restant dû. Il faut alors activer une solution patrimoniale immédiate.
Existe-t-il encore des aides publiques après échéance ?
Oui, mais elles sont limitées et lentes. Elles ne remplacent pas une solution financière immédiate.
Peut-on utiliser une vente à réméré après l’échéance du PGE ?
Oui, tant qu’aucune saisie n’a été engagée. L’acte est signé chez notaire et les fonds soldent le prêt.
Combien de temps prend une opération ?
En général entre 15 et 30 jours selon la complexité du dossier.
La vente à réméré est-elle compatible avec une procédure judiciaire ?
Oui, tant que le bien n’est pas déjà saisi ou adjugé.
Pour comprendre le mécanisme juridique et les avantages de cette stratégie patrimoniale, consultez la page dédiée à la vente à réméré.

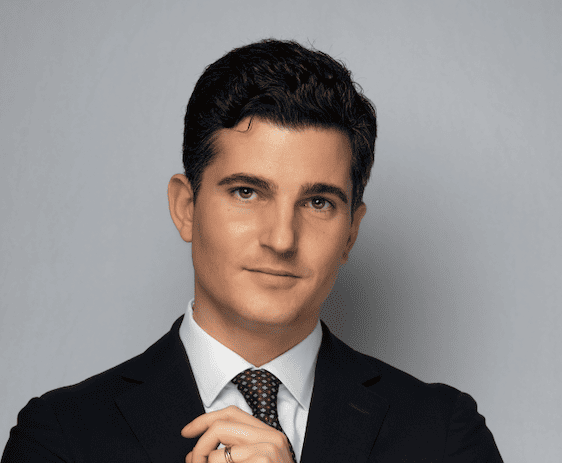




.svg)






