Lors d’un divorce, la question du bien commun — souvent la résidence principale — devient centrale. C’est à la fois un actif patrimonial et un levier financier pour solder les comptes entre les époux. Quand le juge accorde une indemnité compensatoire, le produit de la vente du bien commun peut servir à la régler. Mais cette opération nécessite de respecter des règles juridiques et fiscales précises. Entre partage, fiscalité, délais et financement, comprendre comment utiliser la vente d’un bien commun pour payer une indemnité compensatoire permet d’éviter les conflits et d’optimiser la répartition.
La vente du bien commun, une étape clé du divorce patrimonial
Dans la majorité des divorces, le bien immobilier commun constitue l’élément le plus important du patrimoine. Il peut s’agir d’une résidence principale acquise à deux, ou d’un bien locatif détenu en indivision. Lorsque le juge fixe une indemnité compensatoire, celle-ci doit être réglée par l’un des conjoints, souvent celui qui dispose des revenus les plus élevés ou du patrimoine le plus important. Le bien commun devient alors une source évidente de liquidités. Le produit de sa vente permet de payer tout ou partie de l’indemnité, mais sa répartition entre les ex-époux dépend du régime matrimonial et de l’origine des fonds ayant servi à son acquisition.
Le cadre juridique : partage et liquidation du régime matrimonial
Avant toute vente, il faut liquider le régime matrimonial. Si les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale, le bien commun appartient pour moitié à chacun. Lors de la vente, le prix est partagé en deux parts égales, sauf preuve d’un financement personnel inégal. Dans le cas d’un régime de séparation de biens avec acquisition en indivision, le partage s’effectue selon les quotes-parts inscrites dans l’acte d’achat. Une fois le prix réparti, la part revenant au débiteur peut être utilisée pour payer l’indemnité compensatoire. Si le bien est en vente au moment du divorce, le juge peut d’ailleurs conditionner le versement de l’indemnité à la réalisation de cette vente.
Payer l’indemnité avec le produit de la vente
L’une des méthodes les plus fréquentes consiste à régler directement l’indemnité compensatoire grâce au produit de la vente du bien commun. Concrètement, le notaire chargé de la vente retient la somme correspondant à l’indemnité sur la part revenant au débiteur et la verse au bénéficiaire. Cette opération, simple et sécurisée, évite tout transfert d’argent entre particuliers. Elle est fréquemment utilisée dans les divorces amiables où les deux époux s’entendent sur les modalités du partage. Si le juge a fixé le montant dans un jugement, le notaire exécute la décision en conséquence. Cette option permet d’éviter de contracter un crédit et d’éteindre la dette immédiatement.
Le rôle du notaire dans la répartition du prix de vente
Le notaire agit comme garant de l’équité et de la légalité du partage. Il vérifie que l’indemnité compensatoire correspond au jugement ou à la convention homologuée. Au moment de la vente, il prélève sur le prix la somme due au bénéficiaire, déduit les éventuelles créances communes (crédit immobilier, frais, impôts) et procède à la répartition du solde. Si la vente ne couvre pas entièrement le montant de l’indemnité, le notaire peut proposer un versement partiel immédiat, le reste devant être payé par d’autres moyens (crédit hypothécaire, vente d’un second bien, etc.). Cette flexibilité garantit le respect du jugement sans bloquer le partage des fonds.
Et si le bien commun n’est pas encore vendu ?
Il arrive fréquemment que le divorce soit prononcé avant la vente du bien commun. Dans ce cas, le juge peut ordonner le versement de l’indemnité dès la liquidation, mais le débiteur doit trouver une solution transitoire pour la financer. Deux options s’offrent à lui : obtenir un crédit hypothécaire en se basant sur la valeur du bien, ou conclure une vente avec complément de prix. Le crédit hypothécaire permet de débloquer une trésorerie immédiate sans attendre la vente effective, tandis que la vente avec complément de prix offre un financement temporaire adossé à la valeur du bien en attente d’acquéreur. Ces dispositifs sont détaillés dans Indemnité compensatoire et bien immobilier : quelles solutions ?.
Le cas du rachat de part entre époux
Plutôt que de vendre le bien à un tiers, l’un des conjoints peut choisir de racheter la part de l’autre. Ce scénario est courant lorsqu’un époux souhaite conserver la résidence principale ou protéger les enfants. Dans ce cas, le rachat de part peut être combiné avec le paiement de l’indemnité compensatoire. Par exemple, si un bien commun vaut 400 000 €, chaque part s’élève à 200 000 €. Si le juge fixe une indemnité compensatoire de 50 000 €, le conjoint qui garde le bien pourra racheter la part de l’autre pour 250 000 €, réglant ainsi la totalité de ses obligations. Le notaire formalise ce calcul et l’intègre dans l’acte de partage.
Les contraintes fiscales liées à la vente du bien commun
Sur le plan fiscal, la vente du bien commun est généralement exonérée de plus-value si elle concerne la résidence principale. Si le bien n’est plus occupé, la plus-value est imposable au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. L’indemnité compensatoire versée grâce au produit de cette vente reste, elle, neutre fiscalement : elle n’est ni déductible pour le débiteur, ni imposable pour le bénéficiaire, sauf si elle prend la forme d’une rente. Ce traitement fiscal est cohérent avec les règles exposées dans Indemnité compensatoire : fiscalité et imposition en 2026.
L’hypothèse du bien invendu et de la saisie
Si le bien commun peine à trouver un acquéreur, la situation peut se bloquer : l’indemnité reste due, mais la trésorerie manque. Dans ce cas, le bénéficiaire peut demander au juge l’exécution forcée du jugement. Cela peut se traduire par une saisie immobilière, voire par la vente judiciaire du bien. Pour éviter d’en arriver là, il est souvent préférable d’anticiper et de recourir à un financement temporaire, comme expliqué dans Que faire si vous ne pouvez pas payer l’indemnité compensatoire ?.
Les précautions à prendre avant la mise en vente
Avant de vendre un bien commun pour financer l’indemnité, il est indispensable d’obtenir l’accord des deux ex-conjoints, même si l’un d’eux occupe encore le logement. En cas de désaccord, la vente ne peut être réalisée qu’après une décision judiciaire. Il est également conseillé de faire estimer le bien par un expert neutre pour éviter toute contestation ultérieure sur le prix ou la répartition du produit. Une clause spécifique dans la convention de divorce peut prévoir que l’indemnité sera prélevée en priorité sur le prix de vente, sécurisant ainsi le bénéficiaire.
L’indemnité compensatoire et la succession en cas de décès post-divorce
Si le débiteur décède avant que la vente du bien commun n’ait permis de régler l’indemnité, celle-ci devient une dette de la succession. Les héritiers devront s’en acquitter sur le prix de la vente future ou sur d’autres biens du défunt. Cette situation est développée dans Indemnité compensatoire et succession : que se passe-t-il ?. Pour éviter ce risque, les notaires conseillent souvent d’inscrire l’indemnité comme créance prioritaire à solder dès la vente du bien.
L’intérêt du financement hypothécaire dans ce contexte
Lorsqu’un bien commun n’est pas encore vendu mais dispose d’une valeur nette élevée, un financement hypothécaire peut permettre de débloquer les fonds nécessaires à la fois pour verser l’indemnité et pour gérer la transition du partage. Ce type de financement, garanti par la valeur du bien, permet de respecter les délais judiciaires sans avoir à liquider précipitamment le patrimoine. Il offre également une meilleure flexibilité en cas de désaccord entre les ex-conjoints sur le calendrier de vente.
À retenir
La vente du bien commun est un outil essentiel pour financer une indemnité compensatoire, mais elle doit être encadrée par un notaire et anticipée fiscalement. Le produit de la vente peut servir directement au paiement, à condition que le partage soit clairement défini et que les deux ex-époux coopèrent. En cas de blocage ou de délai trop long, un crédit hypothécaire ou une vente temporaire peut assurer le financement immédiat, tout en préservant la valeur du patrimoine.
FAQ – Indemnité compensatoire et vente du bien commun
Le produit de la vente peut-il servir à payer l’indemnité ?
Oui, le notaire peut retenir la somme sur le prix de vente.
Que faire si le bien n’est pas encore vendu ?
Recourir à un financement hypothécaire ou à une avance sur vente.
Le paiement avec le prix de vente ouvre-t-il un avantage fiscal ?
Non, sauf si le capital est versé sous douze mois.
Faut-il l’accord des deux ex-conjoints pour vendre ?
Oui, sauf décision judiciaire contraire.
Et si le bien est vendu après le décès du débiteur ?
L’indemnité est alors réglée sur le produit de la succession.

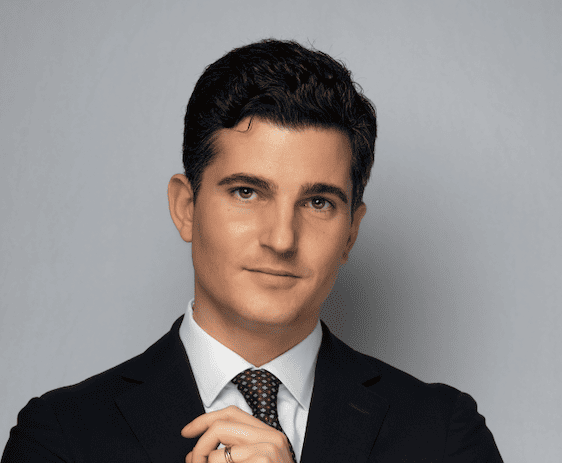




.svg)






