Dire que l’on ne peut pas payer ne suspend pas l’exigibilité d’une prestation compensatoire. Le bénéficiaire peut enclencher des mesures d’exécution, le notaire réclame une preuve de fonds et le temps joue contre vous. La seule stratégie gagnante consiste à transformer très vite une intention en paiement certain, traçable et affecté par l’étude. Cette page vous donne une méthode opérationnelle pour qualifier votre difficulté, bâtir une enveloppe réaliste et mobiliser votre patrimoine afin de régler à temps, sans brader vos actifs et sans vous exposer à la saisie.
Comprendre ce que signifie « impossibilité de payer » dans les faits
L’impossibilité peut être objective, lorsque vos liquidités et votre capacité d’emprunt immédiate sont insuffisantes face au capital fixé par la décision, ou ponctuelle, quand un financement est plausible mais trop lent au regard du délai judiciaire. Dans les deux cas, l’argument ne vaut que s’il est accompagné d’un dossier probant : décision ou convention homologuée, état chiffré validé par l’étude, justificatifs de revenus et de charges, estimation contradictoire du bien si vous mobilisez de l’immobilier et, surtout, plan d’emploi des fonds. Cette matérialité permet au notaire de programmer un acte dès qu’une source de liquidité certaine est identifiée, qu’il s’agisse d’un crédit hypothécaire ou d’une vente à réméré.
Formaliser immédiatement un état chiffré et un plan d’emploi des fonds
Attendre un « miracle bancaire » expose au non-paiement. Faites valider par écrit, par l’étude, l’enveloppe exacte à régler : capital arrêté par la décision, frais d’acte, éventuelles indemnités de remboursement anticipé si un prêt est soldé, charges et taxes à régulariser, petite marge de sûreté. Cet état chiffré, assorti d’un plan d’emploi détaillant l’affectation des fonds, devient le cœur de votre dossier. Il justifie la demande d’un crédit hypothécaire si votre profil est finançable dans le délai, ou l’activation d’une vente à réméré lorsque l’urgence commande.
Utiliser votre bien immobilier pour payer sans le vendre définitivement
Quand l’épargne manque, il faut convertir une fraction de la valeur de votre bien en trésorerie sous contrôle notarial. Deux trajectoires existent. Si l’analyse de solvabilité est favorable et que le calendrier le permet, l’adossement décrit sur crédit hypothécaire crédite le compte étude, le notaire verse la prestation compensatoire, règle les frais et, si besoin, désintéresse la banque selon décompte. Si la vente d’un actif est déjà envisagée mais prendra plusieurs mois, cadrez une avance encadrée chez notaire parmi les options réunies sur prestation compensatoire et bien immobilier afin de payer maintenant sans subir une décote de précipitation.
Passer d’une impossibilité bancaire à un paiement certain grâce au réméré
Lorsque les délais sont trop courts, qu’un incident récent a dégradé votre scoring ou qu’un refus ferme vient de tomber, la seule mécanique véritablement opposable au temps reste la vente à réméré. Vous cédez temporairement le bien chez le notaire, les fonds arrivent sur le compte étude, la prestation compensatoire est payée immédiatement, les frais sont réglés et vous conservez une faculté de rachat à un prix et dans une durée décidés dès l’origine. Vous évitez ainsi la saisie tout en gardant la main pour racheter lorsque votre situation est assainie ou qu’un financement classique redevient accessible.
Synchroniser étude notariale et financeur pour neutraliser le risque de non-paiement
Le notaire ne programme pas sur une promesse, mais sur une preuve de fonds datée et une ventilation signée. Transmettez l’état chiffré, l’estimation, les décomptes bancaires et l’attestation de disponibilité des fonds. Demandez une date « conditionnée à réception des fonds » afin d’aligner toutes les parties. Si l’accord bancaire n’arrive pas, basculez sans délai vers la vente à réméré pour livrer tout de suite la preuve de paiement et éviter les mesures d’exécution décrites sur non-paiement de prestation compensatoire.
Échelonner n’est qu’une souplesse, pas une solution de trésorerie
Un étalement peut être autorisé par le juge ou négocié amiablement, mais il suppose souvent des garanties et un premier versement. Il ne remplace pas une liquidité quand la première échéance est proche. Utilisez-le comme complément à une solution de financement certaine, en respectant les conditions rappelées sur échelonner la prestation compensatoire.
Dimensionner l’enveloppe au centime utile pour éviter le « second tour »
Ne financez pas « juste » le capital. Intégrez frais d’acte, pénalités éventuelles, charges à jour, marge de calendrier. Une enveloppe sous-dimensionnée crée un manque au dernier moment et rallume le risque contentieux. Une enveloppe correctement calibrée, adossée à un crédit hypothécaire ou à une vente à réméré, éteint le risque dès le premier virement sur le compte étude.
Prévenir la saisie en privilégiant un paiement traçable et prioritaire
Dans votre plan d’emploi, la prestation compensatoire doit être réglée en priorité. La traçabilité via le compte étude, la publication des actes et l’affectation des fonds protègent le payeur comme le bénéficiaire. Cette discipline suffit, dans la grande majorité des dossiers, à stopper les poursuites avant qu’elles ne s’installent. Si vous hésitez entre plusieurs leviers, comparez leurs contraintes et leurs délais sur prestation compensatoire et bien immobilier.
FAQ
Comment prouver au bénéficiaire que je paierai rapidement alors que je n’ai pas l’argent aujourd’hui ?
En transmettant via l’étude une preuve de fonds datée, assortie d’un plan d’emploi détaillant l’affectation au versement de la prestation compensatoire. Si la banque tarde, basculez vers une vente à réméré pour fournir immédiatement la preuve de paiement.
Je suis propriétaire mais mon dossier est refusé par la banque. Suis-je condamné à vendre ?
Non. Vous pouvez monétiser temporairement votre bien par une vente à réméré, payer la prestation compensatoire tout de suite et racheter le bien ensuite, ou solliciter un crédit hypothécaire « à froid » une fois la situation assainie.
La date est dans quinze jours : un échelonnement peut-il suffire ?
L’échelonnement est une souplesse utile mais rarement suffisant sans première liquidité. Vérifiez les conditions sur échelonner la prestation compensatoire et, en parallèle, préparez un financement certain via crédit hypothécaire ou vente à réméré.
Quels risques concrets en cas de retard persistant ?
Mises en demeure, voies d’exécution sur comptes et revenus, puis saisie patrimoniale. Le meilleur bouclier est un paiement traçable et prioritaire, comme rappelé sur non-paiement de prestation compensatoire.
Je veux éviter toute vente définitive : quelle option privilégier ?
Une vente à réméré permet de payer immédiatement et de conserver une faculté de rachat. Si les délais s’allongent et que votre solvabilité s’améliore, vous refinancez ensuite par crédit hypothécaire.
Et si je prévois finalement de vendre d’ici quelques mois ?
Évitez la décote d’une vente précipitée. Sécurisez d’abord le paiement avec une solution patrimoniale parmi , puis vendez au bon prix, sans pression.

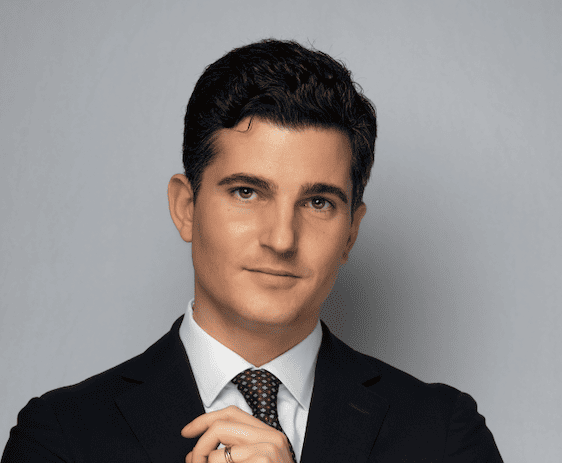




.svg)






